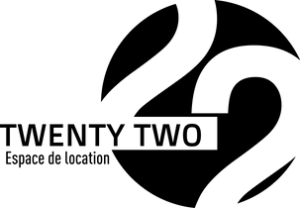Le modèle urbain dominant de la métropolisation est en crise. De plus en plus de personnes aspirent à un autre mode d’organisation de la société. Pour Guillaume Faburel, géographe, enseignant-chercheur à l’Université Lyon 2 et à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, nous devons tourner la page d’une civilisation urbaine de plus en plus concentrée et artificialisée, ouverte il y a quelques siècles, pour une perspective radicalement différente : les biorégions.

Pourquoi la confusion actuelle dans les esprits et pourquoi tant de défiance ?
Nous sommes dans un moment de défiance pour toute parole d’autorité, celle, certes du politique, mais également de la recherche académique. Selon moi, à bon droit, à certains égards : bien des discours scientifiques composent et véhiculent ce que l’on peut qualifier de pensée dominante, en grande partie adossée aux intérêts économiques de croissance.
Et l’analyse des devenirs urbains est typiquement dans ce cas là. Nombre de contenus sont étroitement mêlés à des options politiques jamais véritablement énoncées, celles de la croissance productive et du développement extensif des agglomérations. Elles ont produit un aveuglement face à la crise écologique actuelle profonde que nous connaissons. Et les sciences humaines et sociales se sont inscrites dans cette tendance, avec l’anthropocène pour fable adaptative et souvent technophilique d’aujourd’hui.
Il en résulte un décalage croissant entre les explications données, les solutions avancées et les aspirations sociales non moins croissantes pour d’autres insertions humaines et sociales dans l’environnement. Sur l’urbain par exemple, alors que la densité fait depuis plusieurs décennies socialement question, les mondes segmentés de l’expertise la défendent bec et ongles, sous couvert de vertu écologique, mais dont les arguments ne sont pas pleinement assurés (cf. surconsommations énergétiques dans les grandes villes).
Pourtant, bien d’autres formes de vie s’inscrivent dans des visions autres du monde, ainsi que des compositions bien différentes des connaissances et savoirs. On pense notamment aux pensées indigènes, bien plus à l’écoute des fonctionnements écologiques, ou encore à l’éco-féminisme, bien plus au fait des dominations évoquées. On en est hélas fort loin aujourd’hui en France.
Pourquoi la crise de la ville ou du moins des grandes et très grandes villes ?
Cette vision déconnectée des milieux écologiques de vie a instauré une coupure de plus en plus forte entre la société et l’environnement naturel. Elle a comme modèle spatial des villes de plus en plus peuplées, arrachées de toute nature. Ce sont les « ville-monde » ou villes globales. Ce modèle dominant se décline en France sous la forme des métropoles dans lesquelles on retrouve les mêmes enseignes commerciales et offres culturelles, les mêmes espaces publics et formes architecturales, les mêmes grands équipements pour les déplacements, le divertissement, et les mêmes activités économiques (ainsi que, de plus en plus, les mêmes compositions sociales).
A l’opposé de cette orientation générale et de la compétition planétaire entre grandes places urbaines, campagnes et périphéries, mondes ruraux et paysans continuent d’être exploité.e.s aux fins de développement urbain, avec pour exemple l’agriculture productive ou encore les espaces de loisirs. Cette conception dominante de l’urbain a façonné notre manière d’habiter la Terre sur la longue durée, et notamment par la métropolisation démesurée des 40 dernières années. Nous y avons fait masse contre la nature, au lieu de faire corps avec le vivant. Voici la cause première de l’écocide planétaire. La grosseur urbaine nous a fait franchir la limite, depuis plusieurs décennies maintenant.
Interview réalisée avant le confinement.
Quel sont les effets de la métropolisation ?
Multiples. Urbanistiquement, j’en ai déjà évoqué certains. Mais surtout sociologiquement, écologiquement… sans même parler des changements institutionnels. La métropolisation est tout sauf neutre. Je décrivais ceci en 2018 dans les Métropoles barbares (éd. Passager clandestin). Or, dans ce registre, l’un des effets souvent présentés est que les métropoles attireraient. Il est vrai que, économiquement, les quelques 120 métropoles reconnues mondialement pèsent pour 12 % de la population planétaire et 48 % du PIB international. Il y a donc quelques intérêts économiques à polariser, concentrer, et donc à attirer.
Cependant, cette attractivité est exclusive : certains groupes sociaux en sont les cibles premières lorsque les plus pauvres en sont évincés. Et plus encore, même dans les cibles privilégiées, en France notamment, des questions ont commencé à se poser face aux modes de vie qui y sont développés : hyperactifs, mobiles, connectés… avec sentiment d’accélération et sensation de saturation. Les enquêtes récentes montrent par exemple que les jeunes bien formés sont maintenant moins d’un tiers à vouloir y demeurer.
Et c’est ainsi que, si vous regardez juste les flux résidentiels, vous vous apercevez que seules 5 des 22 métropoles voient leurs populations croître (Lyon, Bordeaux, Montpellier, Nantes et Rennes). En fait, ce sont les espaces extérieurs aux grandes villes, bien moins denses, en substance hameaux, villages, bourgs et petites villes de proximité, qui voient le plus d’installations, par réaction aux concentrations urbaines croissantes. Selon l’Insee, de l’ordre de 0,7 % par an pour les espaces ruraux notamment.
Quelles perspectives ouvrent les biorégions ?
La vision concentrée des peuplements et de l’aménagement est à l’opposé d’une vision polycentrique, telle qu’on la trouve dans des groupements de taille plus humaine. Or, une telle déconcentration à quelques vertus écologiques, au premier chef celle de l’autonomie par la proximité des ressources et leur gestion au plus près de leur renouvellement. Pour information, les parisiennes et parisiens consomment 313 fois plus que la superficie de la ville pour vivre.
Pour cesser d’accélérer dans notre propre roue avec des recettes qui ne font que perpétuer l’exploitation sans limites (quoique) de la nature, que cela soit géographiquement par mécanisation, extractivisme…, mais aussi techniquement par la géo-ingénierie, biomimétisme… et les concepts du moment (ex : ville-forêt), il s’agirait maintenant de faire droit à des biorégions périphériques, territoires gouvernés par la nature, dans le respect du vivant et de sa reproduction.
Cela renvoie clairement à des modèles esquissés dans quelques régions du monde, à l’exemple de celui, certainement aujourd’hui le plus stimulant, de Cascadia, développé dans l’Ouest nord-américain. Appuyé sur un dessein de sobriété écologique et sur les cultures améridiennes de la terre, cette expérience s’inscrit dans une logique de décroissance par déconcentration des fonctions et surtout autodétermination et autogestion des groupes, à l’échelle polycentrique d’un grand bassin versant. On peut aussi citer des expériences en Toscane, mais là dans une logique encore très urbano-centrée et concentrique (notamment par les savoirs techniques mobilisés).
En France, les parcs naturels régionaux se sont-ils approchés de cette démarche ?
Du nom de biorégion, pas à ma connaissance. Mais de sa philosophie, ils auraient pu, par les actions locales, à la fois écologiques et économiques (ex : artisanat), qu’ils cherchent à promouvoir. En pratique cependant, on demeure pour beaucoup dans la pensée centraliste, avec préservation d’espaces remarquables, ne permettant pas toujours d’accueillir, sous condition, de populations qui souhaiteraient développer des formes de vie radicalement alternatives.
On pourrait également dire cela des « pays » géographiques qui, créés en 1995 et au nombre de 352 en France, maillent bien différemment le territoire hexagonal mais n’ont jamais reçu les moyens politiques de leur propre déploiement, en raison de leur délimitation d’abord culturelle. Ils auraient toutefois pu représenter un maillage écologique pertinent. Le fait qu’ils s’appellent dorénavant Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) en dit long sur la logique de développement qui les a rattrapés.
Les intercommunalités pourraient elles s’engager sur cette voie ?
Plus encore que les PNR et PETR, les intercommunalités sont là aussi issues d’une pensée centraliste, celle toujours portée par la même idée de rassembler pour grossir, de concentrer les pouvoirs pour peser. La taille pour leur création a d’ailleurs été récemment revue à la hausse : 15 000 habitants. Et leurs nouvelles (techno)structures appliquent très souvent le modèle développementaliste des métropoles, mais à moindre envergure, avec dynamisation commerciale, équipements structurants, ou nouveaux mobiliers urbains. Tout ceci d’abord sur la base de bassins fonctionnels de vie, et aucunement sur celle des cultures écologiques et sur les milieux du vivant. Là aussi, raté !
Y a-t-il un « bon » niveau de population qui permettrait une organisation urbaine de qualité, aux effets négatifs réduits ?
Cela dépend ce que l’on entend par qualité. De mon point de vue, et c’est que ce que je développe dans le livre récemment publié (Pour en finir avec les grandes villes, éd. Le Passager clandestin), l’organisation pertinente est celle du respect du vivant, avec nous enfin vraiment dedans. Bref, viable et vivable simultanément. Or, ce sont les petites unités qui sont les plus vertueuses. La littérature est claire sur ce point au moins. A condition, il s’entend, de ne pas y importer sine die les modes de vie métropolitains, bref de ne pas arriver avec SUV, 5G, logements surdimensionnés, piscines chauffées… On commence d’ailleurs enfin à regarder quelques-unes des petites villes et des villes moyennes sous l’angle d’avancées agroécologiques et alimentaires, architecturales et paysagères.
Et d’ailleurs, je rappellerais juste que l’on estime en France la surface nécessaire de 200 à 1 000 m2 par habitant.e pour satisfaire les besoins alimentaires, d’abord en légumes avec petit élevage d’appoint, sans intrants ni mécanisation. Cette surface va jusqu’à 2 000 m2 lorsque l’on inclut les dépendances de circulation et de stockage, et les emprises nécessaires à l’habitation et aux services de proximité. En cumulé, cela fait de 1/8 à 1/4 du territoire hexagonal, soit l’équivalent des surfaces déjà artificialisées pour les modes de vie urbains, hors hectares fantômes, c’est-à-dire hors des étendues de terre nécessaires aux artifices du mode de vie urbain. La déconcentration est donc plausible, la relocalisation crédible, la décroissance plus que nécessaire.
Les acteurs porteurs d’un fonctionnement plus maîtrisé, au niveau des communes rurales, des bourgs, de petites villes et des villes moyennes, mais aussi des activités et modes de vie alternatifs sont ils nombreux ?
Les réseaux sont de différentes natures et fonctions, compositions et desseins. Mais force est de constater que cela pullule. Certes, il existe plusieurs associations d’élus locaux de petites villes ou de la ruralité, mais surtout, dans la perspective écologique qui me semble devoir être première, il existe des réseaux nationaux de reprise agricole ou d’implantations d’éco-lieux, de développement des circuits courts ou d’habitats légers… Ce sont Terre de liens, Colibris, Miramap, Halem, InPact, Relier, Reneta… et de très nombreux autres. Mais il convient sans doute de rassembler cet archipel. C’est pourquoi nous organiserons avec une trentaine d’entre elles en mai 2021 en région Auvergne-Rhône-Alpes les Etats généraux pour une société écologique post-urbaine.