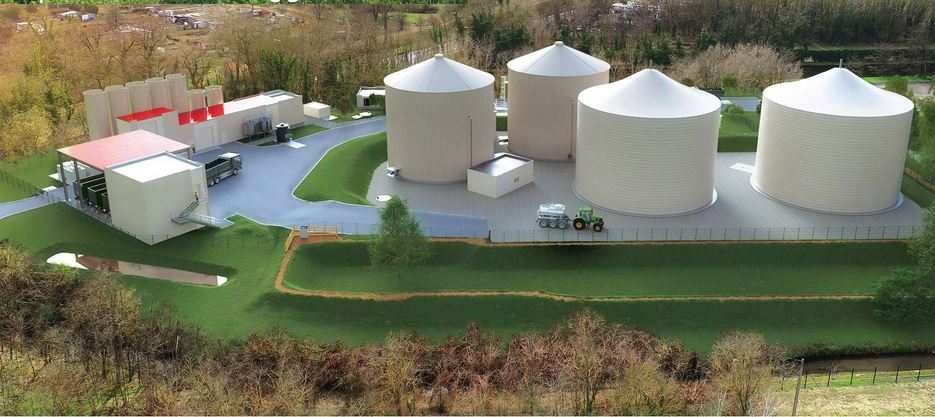L’histoire de l’opinion sur le changement est déjà vieille. Les premières informations ont été publiées en 1932 dans le New York Times. Pendant longtemps, l’information sur le changement climatique a été une affaire d’experts. L’ONU n’en a parlé qu’en 1974, et les entreprises se sont emparées du dossier en 2001.
Mais l’opinion publique appréhende encore mal le sujet. . C’est ce qu’a montré un colloque organisé dans le cadre des 26 èmes Entretiens Jacques Cartier, à Villeurbanne.
Les climato-sceptiques sont largement répandus en France. On a un tiers de climato-sceptiques qui ne croient pas au changement climatique qui ne change pas depuis dix ans. Aux USA, même proportion.
Marchands de doute
L’information est difficile car les climato-sceptiques sont encore nombreux. Pas seulement au niveau du public, mais au niveau de certains « marchandes de doute » comme Claude Allègre.
Internet ne facilite pas l’information. Le réseau pullule de site, de blogs, de réseaux sociaux qui répandant des informations en tous les sens.
Cela est inquiétant alors qu’on a plus d’information, ce qui pose un problème sur le trop d’information.
Et le public peine à comprendre ce qu’est le changement climatique.
Il a une perception limitée aux questions de santé. Le public donne la priorité à d’autre préoccupation, comme le bien-être, les habitudes.
Pourtant le réchauffement climatique concerne chacun, tant ses conséquences seront importantes au niveau de la planète. Mais il est difficile de diffuser des informations en direction des décideurs et du public. La diffusion d’information est difficile car la perspective du réchauffement perturbe. Les perspectives sont lointaines, puisque les spécialistes parlent de 2050, de 2070, de la fin du siècle. Le public pense donc que le phénomène va venir progressivement et qu’il a le temps de voir venir.
Il faut donc informer différemment pour faire comprendre et faire agir. L’information ne doit pas être seulement descendante, du haut vers le bas, mais elle doit être de proximité. L’information doit être concrète.
La question de la confiance place les médias et les chercheurs au cœur des défis. Mais le dialogue entre scientifiques et journalistes est malaisé. Les premiers reprochent aux seconds de ne pas comprendre et les seconds reprochent aux premiers de ne pas de se mettre à la portée du public.
Les craignent d’être piégés par les journalistes.
Communication trop lointaine mais rien dans la communication locale.