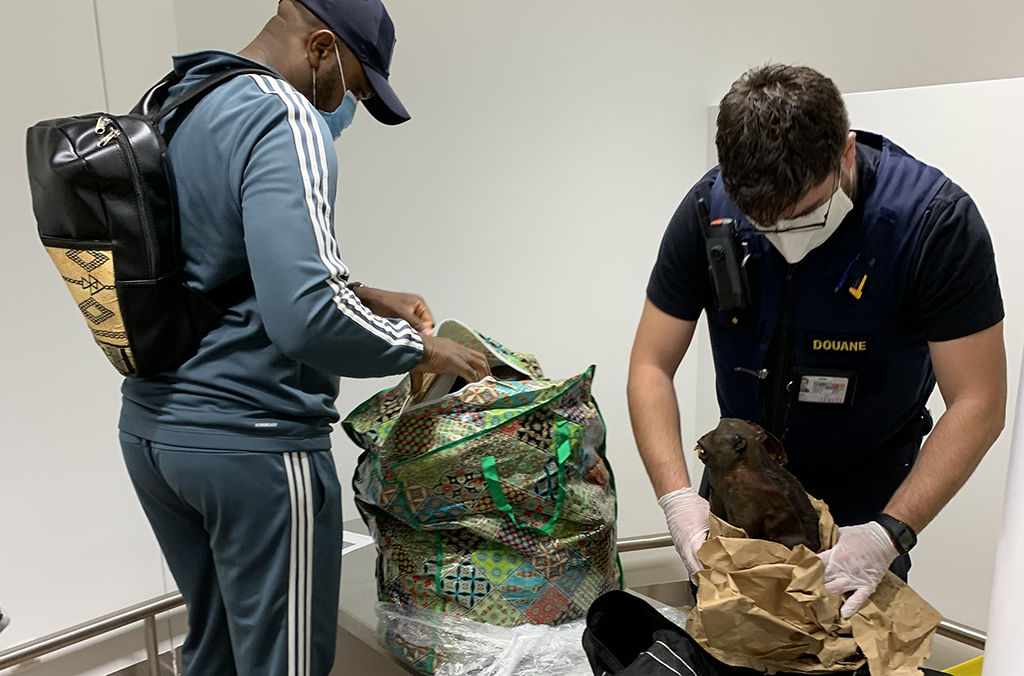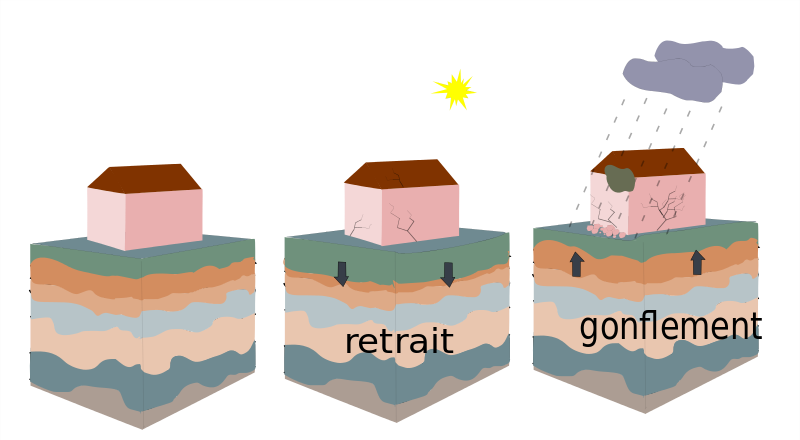L’arrêt définitif du réacteur à neutrons rapides Superphénix est dévenu effectif en 2018, ikl y a trente ans. Le fonctionnement du réacteur construit sur le bord au Rhône, dans le Nord isère,
Superphénix était un réacteur nucléaire définitivement arrêté en 1997, situé dans l’ex-centrale nucléaire de Creys-Malville, au bord du Rhône à 30 km en amont de la centrale nucléaire du Bugey. réacteur à neutrons rapides à caloporteur sodium. Deux raisons ont poussé à la construction de Superphénix : l’anticipation d’une croissance forte des besoins énergétiques, notamment électrique et les limites de l’extraction de l’uranium.
Mais la demande d’uranium dans le monde n’a pas augmenté comme prévu, d’autres énergies ont été développées. Et plusieurs pays, surtout après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, ont tourné le dos au nucléaire, comme deux pays partenaires du projet, l’Allemagne et l’Italie.
L’histoire de Superphénix est jalonnée de manifestations expression du refus du nucléaire par des associations et des citoyens, de bras de fer politiques et juridiques, d’incidents techniques.
Parmi les manifestations, le rassemblement du 31 juillet 1977 fut l’un des plus importants de l’histoire du mouvement antinucléaire. Il reste gravé dans les mémoires avec la mort d’un manifestant de 31 ans, Vital Michalon à la suite d’affrontements violents entre manifestants et forces de l’ordre.
Bras de fer politiques et juridiques
Exemple des bras de fer juridiques et politiques en 1994, la mission initiale de Superphénix — produire de l’électricité —est modifiée. Un décret prévoit que Superphénix devient un laboratoire de recherche et de démonstration. Superphénix redémarre en septembre 1995, occasion d’un bras de fer entre la ministre de l’environnement Corinne Lepage et le ministre de l’Industrie Franck Borotra. En raison d’irrégularités juridiques, Corinne Lepage refuse de signer le décret d’autorisation de redémarrage du réacteur, et menace implicitement le premier ministre Alain Juppé de démissionner.
En février 1997, alors que le surgénérateur est à l’arrêt, le Conseil d’État annule le décret d’autorisation de redémarrage de 1994. Motif : la nouvelle mission confiée à Superphénix aurait justifié une nouvelle enquête publique. Le 19 juin 1997, Lionel Jospin, premier ministre de la République française, annonce : « Superphénix sera abandonné ». Un arrêté ministériel du 30 décembre 1998 conduit à l’arrêt définitif.
Le cout initial largement dépassé
La production électrique de Superphénix est restée beaucoup plus faible que les prévisions théoriques des ingénieurs d’EDF. Au total, le facteur de charge moyen sur la période 1985-1997 a été de 6,3 à 6,8 %.
Selon un rapport du Sénat publié en 1998, le coût de construction et de fonctionnement de Superphénix a dépassé les estimations initiales. En 1997, la Cour des Comptes a évalué ce cout à 60 milliards de francs répartis à concurrence de 51 % pour EDF, 33 % pour l’électricien italien Enel et 16 % pour le consortium SBK, qui regroupe les électriciens allemands RWE, néerlandais SEP et belge Electrabel. compte tenu de la valeur de l’électricité fournie au réseau par le réacteur, les dépenses s’élèveraient, selon elle, à 40,5 milliards de francs.
Si l’on ajoute l’entretien, Superphénix a coûté au total 12 milliards d’euros (actualisé 2010) jusqu’à son arrêt définitif en 1997 selon la Cour des Comptes. Il faut ajouter le prix de son démantèlement qui est estimé à 2,5 milliards d’euros.
Un fonctionnement jalonné d’incidents
Le 8 mars 1987 une fuite de 20 tonnes de sodium liquide se produit dans le barillet de stockage du combustible nucléaire. Ce barillet est une cuve cylindrique où on laisse refroidir le combustible usagé un certain temps, en attente de transfert soit vers le cœur soit vers l’extérieur. Cette fuite était due à un acier mal choisi, ce qui entraîna la fissuration de zones soudées et une fuite de sodium, un incident classé au niveau 2 de l’échelle INES. Le 26 mai 1987, le Ministre de l’Industrie décide d’arrêter le réacteur.
Alors que le réacteur est à l’arrêt un deuxième incident de niveau 2 survient le 29 avril 1990. Une fuite de sodium sur un des 4 circuits primaires principaux impose la vidange immédiate de tout le sodium du circuit incriminé (400 tonnes). En effet, le sodium doit être maintenu pur en toutes circonstances pour éviter en particulier que des impuretés ne viennent boucher le circuit de refroidissement. La purification du sodium prendra 8 mois16.
Le 8 décembre 1990, une partie du toit de la salle des turbines s’écroule sous le poids de 80 cm de neige, nécessitant de reconstruire la superstructure de la moitié du bâtiment. Le réacteur était arrêté. Le bâtiment de l’alternateur et le réacteur étant séparés, il n’aurait donc pas pu y avoir de conséquences graves selon EDF19. Enfin 1994 une fuite d’argon se produit dans un échangeur de chaleur sodium-sodium placé à l’intérieur de la cuve du réacteur. La remise en état durera 7 mois.